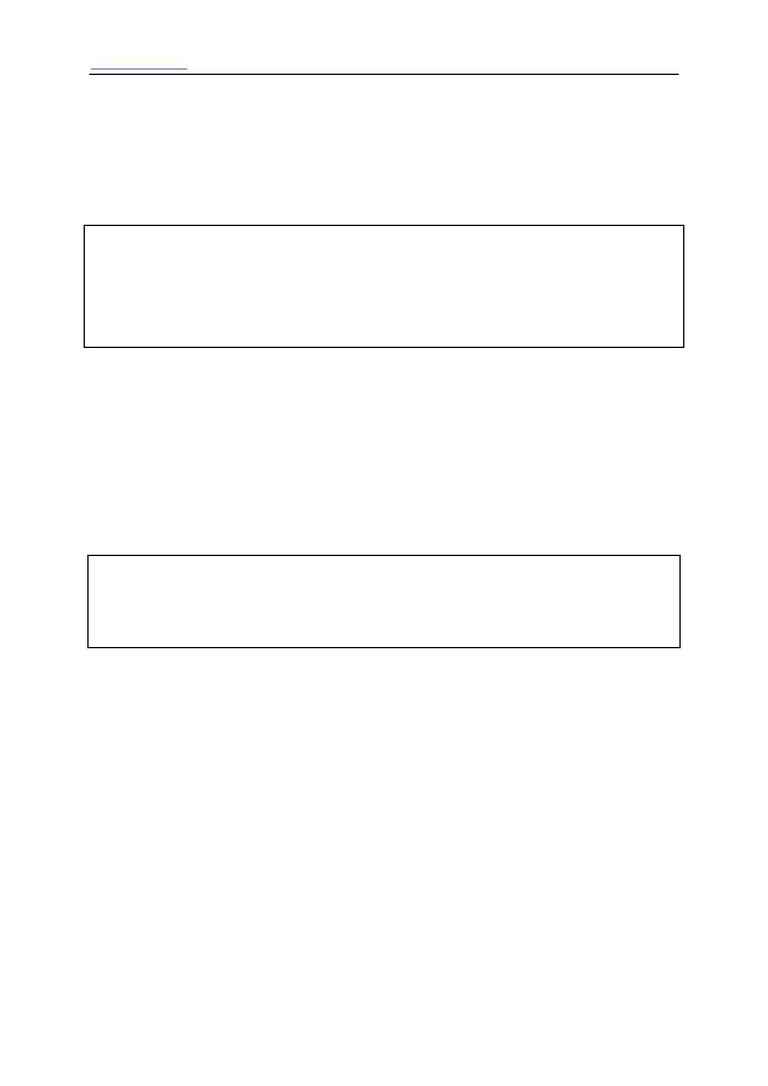
15ème Congrès international des Archives
James-Sarazin
www.wien2004.ica.org
7
4) le risque de présenter une histoire officielle puisque cautionnée par une institution
publique nationale, malgré toutes les nuances et toutes les précautions de pluralité
qui pourraient être prises.
Il convient donc de se recentrer sur la spécificité de l'institution dont dépend le Musée, puisque la
vocation de cette institution est justement de recueillir, conserver et transmettre le matériau fondamental de
l'histoire : les archives. Chaque époque doit interroger de nouveau les documents pour élaborer son histoire de
France : celle-ci n'est pas un objet fini mais un chantier toujours ouvert.
La solution vers laquelle nous nous orientons ne serait pas celle d'un musée de l'histoire de France conçu
comme une frise chronologique narrative des origines à nos jours, mais d'une mise en perspective des discours
historiques qui ont construit cet objet culturel qu'est l'histoire de France.
A une vision exclusive et donc forcément arbitraire, on préférera une approche plurielle du passé
national. À une histoire de France, on substituera des histoires de France, rythmées par des temps différents,
évoluant à des échelles différentes (nationale, locale, familiale, individuelle). Tout au long du parcours proposé,
le visiteur doit pouvoir se forger et se raconter sa propre histoire de France.
Pour ce faire, il conviendra :
1) de relativiser certaines visions trop schématiques de notre passé national.
2) d'éclairer le rôle de tous les acteurs de cette construction tant intellectuelle qu'émotionnelle :
historiens, archivistes, citoyens, etc.
3) d'amener à une réflexion plus générale sur le rapport entre mémoire et histoire (philosophie
de l'histoire), sur le métier de l'historien et ses perspectives.
Ainsi, le visiteur prendra conscience du fait que l'Histoire n'est pas une donnée, un produit
spontané de l'écoulement du temps, mais une création humaine. L'historien (entendu au sens large : toute
personne racontant ou se racontant le passé) apparaîtra lui-même à l'oeuvre au coeur de l'Histoire.
Le Musée tel que nous l'appelons de nos voeux serait ainsi la parfaite illustration des propos de Marc
Bloch : « Tout livre d'histoire digne de ce nom devrait comporter un chapitre [...] qui s'intitulerait à peu près
" Comment puis-je savoir ce que je vais vous dire ? ". Je suis persuadé qu'à prendre connaissance de ces
confessions, même les lecteurs qui ne sont pas du métier éprouveraient un vrai plaisir intellectuel. Le spectacle
de la recherche, avec ses succès et ses traverses, est rarement ennuyeux. C'est le tout-fait qui répand la glace et
l'ennui » (dans Apologie pour l'histoire).
Conscients de l'ambition d'un tel parti pris, nous croyons indispensable de l'adapter à l'attente du public -
ou plutôt aux attentes des publics - en proposant sinon plusieurs discours, du moins plusieurs niveaux de
discours ou plusieurs manières de les appréhender. Entre l'approche mémorielle, quasi hagiographique, voire
fétichiste, et l'analyse scientifique qui se hasarderait à porter un regard épistémologique sur la discipline
historique, faut-il vraiment choisir ?
Pourquoi ne pas partir du connu : un événement, un personnage, un thème et offrir au visiteur la
possibilité de découvrir comment se sont formés les récits (des plus romancés aux plus scientifiques), voire les
légendes et les mythes dont s'est nourrie l'Histoire qui a été inculquée aux générations successives ? Le visiteur
serait invité à reconsidérer des discours historiques largement tributaires des idéologies et des courants d'opinion
dans lesquels leurs auteurs étaient immergés.
De question en question, il s'agit d'aiguiser la curiosité du visiteur, et surtout de l'aider à prendre du recul
par rapport aux événements passés mais aussi présents. Il se rendra compte que notre perception des faits est
déterminée par des facteurs psychologiques, sociologiques, idéologiques, formant le contexte dans lequel est
forgé le récit, contexte parfois fort éloigné de celui du fait considéré.
L'idée se dégage donc d'un musée de l'histoire de France dont le visiteur ne ressortirait pas avec une tête
bien pleine - voire trop pleine - mais avec une tête « bien faite ». Il ne s'agit pas de l'accabler par l'accumulation
d'informations mais de lui offrir une plus grande liberté d'approche et de réflexion sur la réalité d'hier et
d'aujourd'hui. Confronté à toutes ces « vérités » historiques, il serait amené à se forger la sienne, tout en étant
désormais conscient de sa relativité. Dans cette optique, le musée de l'histoire de France répondrait à un
